
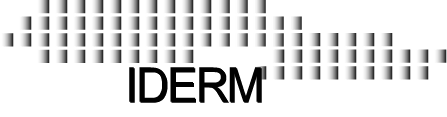
Institut d'études et de recherches Maçonniques
GODF – 16, rue Cadet, 75009 Paris, France –
Tel. : [33] (0)1 45 23 75 06 Fax. : [33] (0)1 42 47 12 87
|
LUMIERE SUR JOURDE L’OBSCUR: Le grand argentier de la Commune de Paris |
par Annette LOHOU
Délégué aux Finances de la Commune de Paris en 1871, François Jourde, un franc-maçon de 28 ans issu du peuple, faisait partie de ceux qui rêvaient d’une république aux mains pures. Le voici cette année à l’honneur. Mais pourquoi est-il resté cent vingt-sept ans au purgatoire ? C’est qu’il eut avec la Banque de France des relations qui ont longtemps senti le soufre …
Jourde, « ce jeune comptable, à la parole facile, à la dextérité rare, était aussi un grand honnête homme. Maniant des millions, il se contentait de prélever dix francs par jour pour son existence », écrit Gaston da Costa, un blanquiste, chef de la police politique, qui sera condamné comme Jourde à la déportation. « Parmi les ennemis acharnés de la Commune, nul n’a pu arriver à salir Jourde. Pendant sa délégation, il eut à résoudre les problèmes les plus difficiles. Il lui fallait trouver chaque jour l’argent nécessaire à la vie de trois cent cinquante mille personnes et à l’alimentation des différents services », indique, de son côté, en 1921, l’historiographe de la Commune C. Talès, dans son livre préfacé par Trotsky.
De l’autre côté de la barrière idéologique et sociale, Georges Wormser, fondateur de la Banque d’Escompte, estimait en 1971 : « Jourde, sorti du peuple, plus ardent que Beslay resté quelque peu bourgeois, Jourde qui a des responsabilités directes vis-à-vis du Comité Central, a été méconnu. Condamné par les juges versaillais, presque oublié de l’histoire, il a tenu de fait et au mieux le principal rôle. Presque jusqu’à la fin, il a su contenir les exigences du Comité Central, plus difficilement celles du Comité de Salut Public. Il ne s’est laissé guider que par la raison, il a fait montre de souplesse alors que débordaient autour de lui les passions et surtout il a su maîtriser ses propres aspirations sociales ».
Hommages à doubles tranchant. Ils tracent en effet le portrait de petit comptable certes intègre et consciencieux mais sans vraie foi révolutionnaire qui colle au dos de Jourde depuis près de cent trente ans. Il le doit à son respect, jugé excessif, du bien d’autrui et de celui de l’Etat, mais surtout à son comportement, jugé trop compréhensif, voire faible, envers la Banque de France. Et, au-delà, envers tout le système économique libéral légué par Napoléon III. Ce que résume l’historien Georges Bourgin en 1971 par : « Naïf Jourde ! Naïf Beslay ! Et plus naïf encore ce Varlin aux mains nettes … ».
Même son atelier maçonnique, Les Zélés Philanthropes, qui l’avait exclu pour « conduite indigne dans la vie profane et non-paiement de ses cotisations », cherchera à oublier Jourde. Il faudra attendre 1984 pour que cette loge évoque son ancien frère dans un ouvrage historique qu’elle édite à l’occasion de son propre cent cinquantenaire. Le livre consacre, sous la signature respectée de Jean Petit, une place substantielle à « l’affaire Jourde », le parcours du malheureux homme y est sérieusement résumé, mais ses seules vertus reconnues sont celles de « pureté », de « candeur » et de « naïveté ».
L’ombre vigilante de Karl Marx plane-t-elle, aujourd’hui encore, sur la réflexion historique appliquée à la Commune ? En 1871, Marx n’avait pas varié depuis son 18-Brumaire paru en 1852 : « Le prochain assaut révolutionnaire en France - disait-il - devra s’attacher non plus à faire passer la machine bureaucratico-militaire en d’autres mains, comme ce fut le cas jusqu’ici, mais à la détruire ». La révolution parisienne déclenchée, il ajoute, pour Kugelmann, le 12 avril : « C’est ce qu’ont tenté nos héroïques camarades de Paris (…). S’ils succombent, la faute en sera uniquement à leur magnanimité. Il eût fallu marcher sur Versailles ». S’agissant de la Banque de France, il écrira, toujours à Kugelmann : « A elle seule, la réquisition (...) aurait mis fin aux fanfaronnades versaillaises ».
On pourrait aussi bien citer Trotsky : le 18 mars 1871, dit-il, « le champ est libre. Mais (…) les « chefs » sont à la queue des évènements (...) et font tout leur possible pour émousser le tranchant révolutionnaire ». Et il enfonce son clou : « Ce fut une grande erreur, dans cette période, de jouer aux élections ».
« Il eût fallu …», « Ils auraient dû…», « Ce fut une erreur …», « Naïfs … ». Or, le raisonnement et le comportement de Jourde ne faisaient que s’inscrire dans ceux de la majorité des dirigeants du mouvement.
UN MILLION CONTRE ONZE SIGNATURES
Le premier rapport entre le pouvoir révolutionnaire et les puissances d’argent (en l’occurrence la Banque de France, qui était alors un établissement privé coté en Bourse, dirigé par des Régents représentant le sommet de la finance et de l’industrie) intervint le lundi 20 mars 1871. Jourde et Varlin, nommés tous deux délégués aux Finances, avaient pris possession des beaux bureaux ministériels de la rue de Rivoli le dimanche 19. Dès le lendemain, donc, à 13 heures, ils étaient dans le bureau du Gouverneur de la Banque de France, Gustave Rouland. Mais pas tout seuls. Neuf autres membres du Comité Central les accompagnaient : Andignoux, Arnaud, Assi, Billioray, Gouhier, Josselin, Mortier, Prudhomme, Rousseau. Onze très jeunes gens, en majorité inconnus du grand public.
Jourde réclame un million. Ce n’était pas une grosse somme. Juste de quoi faire la solde de la Garde Nationale - chaque garde recevait trente sous par jour + 75 centimes pour la femme + 25 centimes par enfant. Il emploie deux arguments. D’une part, il invoque sa légitimité en tant que pouvoir communal (« C’est nous qui représentons la Ville de Paris …[Elle] a ici un solde créditeur …»), d’autre part il menace et met en garde (« Si la solde n’est pas payée, les Fédérés se paieront eux-mêmes »). Le gouverneur, un Normand madré qui avait servi les régimes précédents, paya, mais réclama un reçu. Celui-ci, archivé à la Banque de France, porte les signatures des onze insurgés.
Qui était ce Jourde qui parlait si bien et semblait déjà savoir tant de choses sur les affaires ? Né en 1843 à Chassagne (Puy-de-Dôme), c’était le fils d’un modeste brocanteur de la rive gauche, qui lui avait fait faire de bonnes études à l’institution Hortus, puis à l’école Turgot. Ainsi muni, le jeune homme était entré comme employé chez Aron et Cie, puis chez Frenon-Mussel, « où il se fit remarquer par sa vive intelligence des affaires ». Il avait quitté cette maison pour se livrer, « vers 1868, à une entreprise commerciale qui ne réussit point ». Il fut aussi quelque temps, dit-on, secrétaire du baron de Jouvenel, ancien député. Puis, désoeuvré, il avait fondé un journal nommé Pipe en Bois (surnom d’un camarade) « dont il ne parut qu’un seul numéro ». Plus récemment, on savait de lui qu’il avait été élu sergent du 160ème bataillon de la Garde Nationale, puis secrétaire d’une commission de Gardes Nationaux pour la défense du 5ème arrondissement. Le jour même de l’insurrection, on l’avait découvert membre du Comité Central (il signait les proclamations) et presque tout de suite délégué aux Finances. Quelques jours plus tard, il serait élu membre de la Commune par 7310 électeurs du 5ème arrondissement. Il paraissait populaire.
L’entrevue du 20 mars avec Rouland pèsera lourd. Les communards avaient reconnu la légitimité du Gouverneur et de son raisonnement. En acceptant que leur prélèvement soit porté au débit du compte de la Ville de Paris, ils limitaient leur mission à la capitale. En invoquant des motifs humanitaires (« les fédérés, leurs femmes, leurs enfants ne savent comment ils mangeront demain »), ils se présentaient en solliciteurs. En renonçant aux 243 millions en billets de banque et numéraire, et aux 800 millions en billets de banque neufs auxquels manquait seulement la griffe du caissier (sans parler des titres et bijoux), que recélait la Banque de France, ils répudiaient toute violence et s’engageaient dans une collaboration imprévisible. Et s’ils étaient les continuateurs de la Ville de Paris, pourquoi ne pas s’être octroyé une délégation générale de signature qui aurait évité tout quémandage ? En somme, c’était une opération comptable, tout juste ambiguë et forcée. Mais, en la signant à onze, ils engageaient le Comité Central, et à sa suite la Commune. La satisfaction était telle que, le jour même, le Journal Officiel avisa : « A partir de demain, la solde de la Garde Nationale sera faite régulièrement ». Tous savaient pourtant qu’avec un million seulement, il faudrait retourner tendre la main.
Et c’est ce qui se produisit. Jourde et Varlin, cette fois seuls, reviendront le mercredi 22, réclamant un autre million. Accord de principe du Gouverneur, mais qui ergote : il me faut, dit-il, consulter le Conseil de Régence. Cela fait, il ne leur délivre que 150 000 francs, puis, devant leur colère, encore 150 000 francs, contre un autre reçu, qu’il rédige lui-même. Mécontents, les deux délégués reviennent le jeudi 23, exigent un deuxième acompte de 350 000 francs, ne l’obtiennent pas, repartent aux Finances, d’où ils envoient à la Banque une lettre menaçante et vexée, restée fameuse (« Nous ramassons le gant qui nous est jeté (...). Nous ne nous représenterons pas devant elle »). Ils exigent le solde du million « avant midi ». Le Gouverneur, qui veut toujours être couvert, réunit encore le Conseil de Régence, lequel, apeuré, débloque les fonds. Comme Jourde et Varlin restent au ministère, l’argent est versé entre les mains de Faillet et Durand, armés, escortés, qui « invoquent un malentendu » et contresignent un reçu où la remise est assimilée à une « réquisition ».
Péripéties, certes, mais hautement significatives de l’aspiration d’une grande partie du Comité Central à la légalité, dès le départ. Jourde et Varlin, sans aucun doute, rêvaient d’institutionnaliser leur pouvoir et, pour ce faire, se sentaient soutenus. Tout le prouve, même le papier à lettres qu’ils utilisèrent souvent (Ministère des finances, Cabinet du Ministre), quitte à le revêtir de tampons républicains et de Liberté-Egalité-Fraternité. Le 26, eurent lieu des élections qui consacrèrent l’insurrection. Ils n’en deviendront que plus raisonnables. Le 27, ils écrivent poliment au Gouverneur « de bien vouloir tenir à leur disposition (…) la somme de cinq cent mille francs ». Plus lourd de sens encore : ils promettent à bref délai « le remboursement de cette avance » et concluent par leur « considération distinguée ». Plus question de réquisition. Ils s’intégraient. La Banque paya.
LE DELEGUE DE LA COMMUNE A LA BANQUE DE FRANCE EN 1871 : CHARLES BESLAY, EX-INDUSTRIEL, EX-BANQUIER, FRANC-MACON DEPUIS 1815
Deux nouveaux acteurs apparaissent alors sur la scène : De Ploeüc et Beslay. Le marquis Alexandre de Ploeüc, deuxième sous-gouverneur de la Banque de France, catholique papiste et royaliste, homme de sang-froid qui venait de passer sept ans à négocier en Turquie où il fonda la Banque Ottomane, remplaçait le gouverneur Rouland. Celui-ci était parti à Versailles rejoindre Thiers pour constituer auprès de lui une « Banque de France bis ». Avec l’argent des succursales de province et de la planche à billets de Clermont-Ferrand, cette deuxième tête allait permettre aux Versaillais de se passer du trésor parisien, de payer les Prussiens (toujours sur le sol français) et de refaire une santé à l’armée française. Pendant la Commune, Thiers recevra ainsi 257 millions.
Charles Beslay, 76 ans, doyen de la Commune, avait été élu le 29 mars membre de la Commission des Finances aux côtés de Jourde et Varlin, et aussitôt nommé délégué à la Banque de France parce qu’on le tenait pour un spécialiste des questions de crédit. Le seul, apparemment. Breton comme de Ploeüc (et Trochu), franc-maçon comme Jourde, c’était un proudhonien, un réformiste ouvertement ennemi de l’usage de la force. Un homme d’affaires de gauche, dirait-on aujourd’hui, qui tout en s’enrichissant dans différentes innovations, était resté passionné de politique. Il avait d’ailleurs été député, et son père aussi. Après une entrevue contrastée, de Ploeüc lui affecta un bureau près du sien. Beslay reconnut « les droits des actionnaires » de la Banque et déclara qu’il ne voulait « prendre aucune connaissance des comptes courants (…) autres que ceux de la Ville de Paris ».
A eux trois, le marquis de Ploeüc et les FF :. Jourde et Beslay allaient écrire l’histoire financière de la Commune. Si le marquis défendait ouvertement ce qu’il appelait « la hiérarchie des fortunes », Jourde et Beslay eurent jusqu’au bout le sentiment profond d’œuvrer pour l’intérêt général. Leurs rapports mériteraient d’être décrits dans les détails, car leur connaissance est essentielle à la compréhension de l’histoire de la Commune. Mais il a fallu attendre 1996 pour qu’un jeune chercheur universitaire, Eric Cavaterra, leur consacre un mémoire serré et sensé. Une version grand public serait éminemment souhaitable. Dans cette attente, citons quelques faits, de nature surtout financière (le reste étant abondamment connu), dans lesquels Jourde joua un rôle capital.
Du 20 au 30 mars, première et délicate décade de la révolution communarde, la Banque de France lui versera, en sept paiements variant de 150 000 à 1 million de francs, un montant total de 2 750 000 francs. Une somme insuffisante pour faire face aux dépenses inventoriées : solde des Gardes Nationaux, secours à leurs familles, effort de défense … Aussi, le 3 avril, le voilà qui hausse le ton. Il redemande un million. La Banque regimbe, s’abritant derrière son Conseil de Régence, qui se permet de lui rappeler sa promesse de rembourser et, en conséquence, pointe du doigt la dette grossissante. Et elle ne paye qu’en trois fois (3, 4 et 6 avril). Bon, se dit Jourde, prenons acte. Dans ses reçus, il n’invoquerait plus que la force (« réquisition »), ce qui arrangeait la Banque et, provisoirement, ne parlerait plus de remboursement. Mais il lui faudrait trouver d’autres sources de financement. Il laissa la Banque tranquille pendant près de trois semaines. Pas question de saisie ni de violences.
Il entreprend de réorganiser l’octroi au profit de la Commune. La Banque de France refuse de lui prêter ses voitures, comme elle le faisait jusque-là, pour récolter les taxes. Mais il y parviendra. D’autres sources fiscales alimenteront son escarcelle. Dans leur précipitation à fuir, les trésoriers du ministère avaient laissé des sommes importantes dans les coffres. La poste parisienne refonctionnait. Les Contributions Directes aussi « remarchent, quinze cents républicains actifs [faisant] le travail de dix mille personnes, véritable population de parasites » (J.O. du 3 avril). L’impôt rentrait de nouveau, timidement certes. Jourde laissera ainsi l’image justifiée d’un réorganisateur des services publics abandonnés par leurs chefs. Finalement, l’argent de la Banque de France ne représentera que 40% de ses recettes. Il aurait aimé s’en passer.
Il lui faudra pourtant se rendre à l’évidence : il devait retourner à la Banque. En solliciteur ? En conquérant ? Moments de flottement. Quelqu’un à la Commune voulut dissoudre le bataillon armé qu’avait formé la Banque avec son personnel – comme avaient eu le droit de le faire d’autres administrations « publiques et particulières » de Paris. Mais le décret publié dans ce but le 3 avril ne put trouver d’application. Le marquis de Ploeüc n’avait pas hésité pas à brandir un autre décret de … 1792 stipulant que les employés comme les siens étaient mobilisés dans leurs bureaux. Sorti d’une époque révolutionnaire et vénérée, ce texte le protégea comme un talisman. Beslay, de toute façon, se serait opposé à toute saisie, y voyant le plus sûr moyen de ruiner la confiance dans la monnaie. Il fallait en effet faire attention, car le cours forcé du billet de banque ne datait que de la guerre et une révolte sur ce motif eut été ruineuse.
LE 22 AVRIL 1871, LA BANQUE DE FRANCE OUVRE UN COMPTE A LA COMMUNE DE PARIS
Acharné à se présenter comme le respectable représentant d’un pouvoir légitime, Jourde tenta une opération de nantissement. Le 21 avril, brusquement à court d’argent, il demande trois millions à la Banque de France, tout en lui proposant, en gage, des « titres émis en exécution du décret [impérial] du 24 juillet 1870 et revêtus des garanties antérieures à l’établissement de la Commune. Les conditions de remboursement du prêt et de l’intérêt affecté seraient indiquées par la Banque de France …»). Non sans hauteur, les Régents refusent, invoquant une vieille ordonnance du temps de Louis-Philippe. Jourde fait comme s’il s’y attendait : le lendemain 22 avril, il devient sec (« Deux millions me sont indispensables dans le plus bref délai (…). C’est une réquisition que je vous adresse … »). Et il propose derechef ses titres. Epaulé par Beslay, il obtient ses deux millions. Mieux : la Banque ouvre à la Commune un compte courant de dépôts de fonds … Une forme de victoire, à ses yeux.
Jusqu’à cette date, il faut le souligner, Jourde agissait en plein accord avec Varlin. Le passé de celui-ci était prestigieux. Il était l’un des artisans de la renaissance du mouvement corporatif et surtout de l’implantation en France de la Ière Internationale. Leur connivence datait du 19 mars, lorsqu’ils avaient durement négocié, tard dans la nuit, le ralliement des maires d’arrondissement (comprenant Clémenceau). Presque en vain, puisque la base des insurgés n’en voulait pas. Ce fut comme si, lors de ces premières journées, s’était forgée leur méthode : légalisme et institutions d’abord, sans jamais négliger la pression populaire. Le 1er avril par exemple, lorsque des gardes nationaux s’étant emparés, pistolets au poing, de la caisse d’un poste d’octroi, c’est Varlin qui avait protesté contre « cette usurpation de pouvoir de la part de quelques membres du Comité Central ». Malheureusement, Varlin allait être affecté aux Subsistances (21 avril) puis à l’Intendance (5 mai). Jourde restera donc seul à la tête des Finances de la Commune.
L’un et l’autre savaient mesurer la portée des symboles. Ainsi en fut-il lors de la tentative de frapper monnaie. Pétris de réminiscences des révolutions précédentes, mais prudents tout de même, des communards abrités par Varlin s’étaient mis en tête d’émettre, non pas une monnaie nouvelle, assez difficile à lancer, mais de nouvelles pièces de monnaie. C’était un peu contradictoire avec l’affirmation tant réitérée que la Commune de Paris ne faisait que prendre la suite de la Ville de Paris, mais il s’agissait de montrer la souveraineté, le sérieux et la volonté de durée du nouveau pouvoir. On était à la mi-avril.
Jourde et Beslay, appuyant l’initiative, négligèrent les objections pertinentes du marquis de Ploeüc (« le droit de battre monnaie est un droit régalien qui appartient à l’Etat seul » et « le numéraire ne fait pas défaut à la circulation ») et réclamèrent les lingots d’argent que détenait officiellement la Banque, pour 1,1 million de francs. On les ajouterait à l’argenterie aristocratique récupérée ça et là. Le 24 avril, Jourde fit occuper la Monnaie, où s’installa l’international Camélinat. Il notifie cet état de fait à la Banque le 4 mai, de Ploeüc s’incline et, dès le 8 mai, la Banque reçoit les nouvelles pièces. Pas nombreuses peut-être, mais elles avaient été fabriquées avec les « coins » datant de la Révolution de 1848, et cela se voyait ! En outre, elles étaient impeccables. Entêté, Beslay réclamera encore les 3 200 000 francs d’argent aurifère qu’avait la Banque. Camélinat frappa 220 000 pièces.
PERSONNE N’AURAIT PU EMPÊCHER UNE TENTATIVE SERIEUSE D’OCCUPATION DE LA BANQUE DE FRANCE
Autre symbole : les diamants de la Couronne. Avant de s’enfuir, l’impératrice Eugénie avait demandé à la Banque de France de mettre ces joyaux en lieu sûr, ce que le gouverneur Rouland avait accepté. Ils avaient été joints à l’or de la Banque, qu’on envoyait à Brest pour le soustraire aux Prussiens. Le tout fut caché dans une casemate puis déposé sur le navire-école Borda qui, en cas de danger, avait ordre de rallier l’Angleterre où l’attendaient des Rothschild. Mais Rouland avait délivré un reçu si alambiqué qu’on pouvait en déduire que les diamants étaient encore à Paris, dans un coffre de la Banque de France. Et Jourde avait mis la main, aux Finances, sur ce document. Les diamants de la Couronne ! Il fallait vite les saisir.
Le 13 avril, il arriva à la Banque, accompagné de Varlin mais aussi d’Amouroux et de Beslay.
Amouroux, surexcité, voulait perquisitionner. Pour ramener le calme, il fallut une lettre signée Delescluze et Tridon aux « citoyens délégués aux finances ». Mais le malentendu ne se dissipa totalement qu’au prix d’une contorsion digne d’être rappelée : le marquis de Ploeüc (qui ne savait rien) proposa d’envoyer quelqu’un à Versailles réclamer la vérité au gouverneur en fuite, Beslay accepta cette idée, et c’est Rigault lui-même qui fournit un laissez-passer pour franchir les contrôles. L’émissaire revint avec des explications apaisantes signées Rouland. Oui, disait le Gouverneur, les diamants étaient loin de Paris et n’y reviendraient pas de sitôt … Qu’en auraient-ils fait ? Les vendre aurait été impossible ou compromettant. Mais, c’est sûr, la liesse eut été grande, la Commune eût paru terrasser le fantôme de l’Empire et remplacer vraiment les gouvernements Trochu et Thiers. Ils remisèrent leur rêve.
Il n’est pas douteux que le comportement de Jourde ait eu des adversaires critiques. Mais ils n’agissaient pas. On le crut pourtant le 12 mai au matin, lorsque la Banque de France fut cernée par des gardes nationaux renforcés par des troupes populaires appartenant « aux Vengeurs de Flourens, aux Garibaldiens etc ». Un jeune homme nommé Le Moussu, commissaire de police, commandait l’opération, s’affirmant mandaté pour perquisitionner la Banque, que Paschal Grousset, délégué à la Guerre, tenait pour « le quartier général de la réaction » et un dépôt d’armes. De Ploeüc se cacha, se croyant visé. On alla chercher Beslay, malade, à son domicile : il sermonna Le Moussu au nom de l’économie politique et de son propre mandat. Le Moussu reçut « de nouveaux ordres » et évacua ses troupes. Pourtant le bataillon de la Banque n’aurait pu arrêter une tentative sérieuse ! Malin, Jourde arrive l’après-midi, feignant d’endosser la manœuvre. Il suggère à de Ploeüc de confier aux Fédérés « au moins le poste extérieur », essuie un refus prévisible, réclame alors la poursuite des avances de la Banque de France (il recevait 400 000 francs par jour depuis le 6 mai). Le Conseil de Régence acquiesça.
Qui avait lancée la tentative ? Le Comité de Salut Public, ou simplement des blanquistes comme Rigault ou Ferré ? En tout cas une minorité de membres de la Commune. Comme l’écrit Eric Cavaterra : si Jourde « ne songea jamais à s’emparer » de la Banque de France, « la grande majorité d’entre eux, dans l’exercice de leur mandat communal, ne soufflèrent mot sur cette question ». Chercha-t-on sérieusement à abattre le marquis, à remplacer le vieux Beslay par un gouverneur nommé par la Commune ? Non plus. Or les objections de Jourde et Beslay n’aurait pas pesé lourd face à la détermination d’un groupe d’extrémistes organisés. L’idéologie de la Commune ne s’y prêtait tout simplement pas. La Banque de France était un symbole trop lourd pour tous. Au demeurant, dans les derniers jours, quand Paris s’embrasa, la Banque resta intacte.
Jourde pouvait d’autant mieux s’estimer mandaté pour agir comme il le faisait, qu’il avait été, dix jours auparavant, confirmé dans ses fonctions par un vote frôlant l’unanimité : 38 élus de la Commune sur 44 présents lui avaient demandé de reprendre sa démission. Pourquoi cette démission ? D’abord à cause de la constitution du Comité de Salut Public dont le seul nom disait les intentions et ne pouvait qu’épouvanter les classes moyennes. Mais aussi parce que quelques voix s’élevaient, dont certaines venimeuses comme celle de Félix Pyat dans son journal Le Vengeur (« Le gouverneur de la Banque de France fait chaque mois son compte de caisse et le publie. Pourquoi le délégué aux Finances de la Commune n'en ferait-il pas autant ? Est-il moins probe ? (…) La caisse de la Commune doit être de verre » etc).
Non seulement son bilan fut approuvé, mais aussi sa pensée, en même temps que sa personne était l’objet de marques de respect et d’affection. Selon son rapport, ses recettes atteignaient 26 millions de francs, dont 7,7 provenant de la Banque de France, et 8,5 de l’octroi. Le reste avait été trouvé aux Finances ou exigé des propriétaires d’entrepôts de tabac. Il n’avait dépensé que 25,1 millions (réalisant donc un excédent budgétaire !) dont il avait donné 80% à la Guerre et 7% à l’Intendance. L’Enseignement, la Justice, le Travail, n’avaient eu que des miettes – la Commune avait des idéaux et peu de volonté. Il s’agissait d’un bilan à mi-parcours, mais ils ne le savaient pas.
NE REVENONS PAS A 93 ! S’ECRIE JOURDE. IL VOULAIT FAIRE DU « SOCIALISME PRATIQUE »
Exprimée ce jour-là, la pensée de Jourde n’est pas moins claire que ses comptes, même si elle n’atteint pas des sommets. Au nom de la valeur du franc et de la confiance que même les Prussiens doivent garder en lui, il s’oppose, par sa démission, à ceux qui veulent le voir procéder à des saisies de titres. Il affirme : « C’est dans nos finances, selon moi, qu’est le salut de la Commune et de la République ». Il évoque, et il paraît avoir été le seul à en avoir conscience, l’évolution de l’environnement international : « Ne revenons pas à 93. Les conditions économiques sont complètement changées. En 93, le pays vivait de ses produits. Aujourd’hui, il vit surtout de l’échange de ses produits contre les produits étrangers et, ces produits, il faut les faire venir. Avant tout, il faut rassurer l’échange des produits. Ce n’est qu’en procédant de cette manière qu’on pourra donner aux travailleurs des instruments de travail, de lutte. Je croyais faire, en agissant ainsi, du socialisme pratique … ». La mondialisation, déjà … Et il a cette phrase saisissante : « Pour atteindre mon but, il faut que (…) les délégués puissent faire des marchés sur toutes les places d’Europe ». Pyat s’excusa. Jourde, réconforté par presque tous, reprit sa démission et le « socialisme pratique » passa à la postérité.
Un autre élément surprenant de ce dossier, qui en recèle beaucoup, resta longtemps occulté. Il s’agit de l’aval donné par Versailles à la Banque de France concernant le financement de la Commune de Paris. Dans la deuxième quinzaine d’avril, il apparut aux Régents (de moins en moins nombreux à Paris) que les demandes de Jourde allaient épuiser le solde créditeur du compte de la Ville de Paris. Que faudrait-il faire lorsque la Commune serait … dans le rouge ? Voilà ces messieurs effrayés à l’idée de prendre seuls la responsabilité de soutenir une insurrection. Le 28 avril, le marquis de Ploeüc écrit à Rouland, lui explique tout en détail et lui annonce que, « nonobstant le grave danger …», il va cesser tout versement s’il n’est pas couvert. Une première réponse arrive, pleine d’atermoiements. Très ferme, le Conseil réitère alors sa demande. Cette fois, le ministre lui-même répond : « …Le gouvernement ne saurait trop vous encourager à persister dans les moyens employés par vous … ». C’était là un blanc-seing, et il n’est pas douteux qu’il fut donné après consultation d’Adolphe Thiers … On était le 1er mai 1871.
Bien que le fossé continuât à se creuser entre le Comité de Salut Public – dont il refusait d’être « le commis » et qu’il avait traité de « dictature » - et une « minorité » où il figurait avec Beslay, Varlin, Fränkel, Tridon, Malon, Courbet, Vallès, Lefrançais etc, Jourde poursuivit obstinément sa démarche, en se servant de la crainte que les autres inspiraient. Le 5 mai, voulant disposer d’une meilleure perspective dans sa gestion, il demande à la Banque de France 10 millions pour dix jours. Somme apparemment énorme en regard de ce qu’il obtenait jusque-là, et pourtant il ne changeait guère d’échelle journalière. Requête rejetée « par un silence significatif ». Cependant, tout aussitôt, le voilà qui présente à de Ploeüc, entouré de quelques régents, un plan qui revient strictement au même. La Banque de France, dit-il, pourrait encaisser à ma place les recettes de la Commune, et si elles étaient insuffisantes par rapport à mes besoins, elle les complèterait à concurrence d’un million par jour …
Comptablement, c’était presque ce qui se passait. Mais, politiquement, c’était habile de la part de Jourde, qui aurait enfin obtenu par ce pacte la reconnaissance officielle de la Commune comme interlocuteur de la Banque, à laquelle il tenait tant. Trop habile, et même explosif pour les banquiers qui repoussèrent « une sorte de solidarité que le but et le rôle de la Banque ne lui permettent point d’accepter ». Il n’empêche : dans les faits, Jourde acquit ce jour-là, dit Eric Cavaterra, « la délivrance automatique et quotidienne de fonds qu’il considère comme indispensables ».
A force de jouer les médiateurs pacifiques, Jourde prenait des risques. Les derniers jours, il subit une dramatique pression de ses collègues. La Commune, mal défendue, ne pouvait empêcher la situation militaire de se dégrader. Les Versaillais se rapprochaient. Le 19 mai, il écrit à Beslay : « Coûte que coûte, il faut que demain, avant midi, j’obtienne au moins cinq cent mille francs. Si je succombais une heure, vous savez ce qui en résulterait … Je puis, en étant soutenu, éviter des écarts et des violences que notre situation explique et que je ne reproche pas à nos collègues ». Et de terminer par son « respectueux et fraternel salut ». Beslay donne la lettre à de Ploeüc, qui fait ensabler les caves avec son encaisse et ses registres. Le 20 mai, à 18 heures, Durand, caissier de la Commune, arrive avec une nouvelle lettre de Jourde inquiet et fâché : « Faites donc le nécessaire auprès de la Banque pour lui faire comprendre quel intérêt il y a à obtenir cette somme. Sans cela ! ! ». Ces derniers mots font peur. Durand, débonnaire, explique que « la Commune, le Comité de Salut Public, le Comité Central, le Comité Fédéral … chacun ordonnance des dépenses qu’il faut satisfaire ». Trop tard : l’armée française reprenait Paris.
Mais ce n’était pas fini. Le 21 mai, Beslay décide de coucher à la Banque. Le 22 mai, la Banque enferme son personnel et interdit l’entrée au public. Des barricades s’élèvent tout autour. Arrive une lettre : « Au nom du Comité de Salut Public, sommation est faite à la Banque de France de remettre au citoyen Jourde la somme de cinq cent mille francs ». Signé Ranvier et Eudes. Jourde, chapeauté, contresigne, et ajoute de sa main : « Si cette somme n’était pas servie, la Banque serait envahie immédiatement … ». La Banque s’exécuta. Le lendemain matin 23 mai, même scène, avec toutefois une différence : des gardes nationaux étaient postés près de la Banque. Cinq cent mille francs, ce n’était toujours pas cher payer. La Banque paya. Les Fédérés s’en allèrent. Ce même 22 mai, Jourde (ainsi que Vallès et Langevin) avaient vigoureusement protesté contre le projet du Comité de brûler le Grand-Livre de la Dette – de quoi affoler tous les rentiers de France.
Ce fut le dernier prélèvement de la Commune à la Banque de France. Du 20 mars au 23 mai 1871, Jourde avait obtenu de la Banque de la Banque 16 695 202, 33 francs, délivrant 39 reçus signés et tamponnés. Sur ce total, 9 401 879, 33 appartenaient à la Ville de Paris, à qui la Commune succédait, et 7 293 323, 00 francs avaient versés à découvert par la Banque de France avec le blanc-seing de Versailles. De toutes parts, on reprochera à Jourde d’avoir procédé à ces réquisitions - la droite trouva que c’était trop, l’extrême-gauche jura que c’était peu et surtout bien trop poli. Plus curieux, on reprochera aussi au marquis de Ploeüc de lui avoir cédé. Le découvert de la Commune deviendra l’interminable « affaire des 7 millions ».
Au ministère des Finances, Jourde mit ses affaires en ordre. Le bâtiment commençait à brûler. On le signale passant à l’Hôtel de Ville, faisant une dernière fois la solde de la Garde. Pour certains, « il reprit son fusil », emportant un cahier d’écolier sur lequel il avait tout noté. On le vit sur les barricades, du côté de la Bastille. Puis il rentra dans son 5ème arrondissement, espérant se soustraire à la fureur sanguinaire. Il fut arrêté le 30 mai, à 1h du matin , rue du Bac, près des « décombres encore fumants de la Caisse des Dépôts et Consignations ».
ATTACHE A SA LOGE ET A L’ORDRE MACONNIQUE
Jourde était franc-maçon. Il le fut avant, pendant et après la Commune, et il ne serait pas juste de mettre en doute son attachement à l’Ordre maçonnique ni à sa loge, même si son assiduité fut versatile. Fougueux jusqu’à l’emportement, dispersé jusqu’à l’oubli de devoirs élémentaires, mais toujours respectueux des principes et des formes, il fut ceux qui donnèrent ces jours-là, à la franc-maçonnerie, un éclat qu’elle ne croira pouvoir s’attribuer à elle-même que bien plus tard.
Il reçut la lumière le 9 novembre 1866, âgé seulement de 23 ans, dans la loge Les Zélés Philanthropes, un atelier constitué à Vaugirard fin 1834. Les deux tiers de ses membres étaient nés au profond de la France, puis étaient venus à Paris ou alentour en rêvant de liberté et de prospérité. Avec une forte proportion de « petites gens, boutiquiers, artisans, ouvriers et employés dont les moyens sont limités », la loge – 63 membres actifs – a une composition représentative de la population des agglomérations proches de Paris, avant la grande industrialisation. Vaugirard même (intégré dans Paris en 1859-60) abritait déjà quelques usines. Tout autant que parmi le peuple du 5ème arrondissement de Paris qui était son berceau et où ses parents, des Auvergnats arrachés à leur terre, donnaient le spectacle « du travail et de l’épargne », c’est là qu’il put mesurer la précarité d’existences où le paiement d’un loyer, l’alimentation quotidienne, le respect des échéances prenaient une importance vitale. Et c’est chez Les Zélés Philanthropes qu’il put commencer à montrer ses talents d’orateur.
La loge était « dédiée à Saint-Jean d’Ecosse, sous le signe distinctif Les Zélés Philanthropes Ecossais ». Les travaux de la loge devaient donc se dérouler selon le Rite Ecossais Ancien Accepté, dont on sait la rigueur et la longueur. Elle convoquait deux tenues par mois, le 2ème et le 4ème vendredis, immanquablement précédées d’un déjeuner dans un restaurant appartenant à un frère de la loge. Elle organisait aussi un banquet solsticial annuel, dont il fallait prévenir l’obédience qui, à son tour, sollicitait une autorisation de la police. Tout cela nécessitait une correspondance et une organisation précises, bien avant le téléphone et l’automobile : il lui fallait donc des administrateurs dévoués et compétents. C’est dire qu’était crucial le rôle du vénérable et de ses officiers.
Jourde avait été mené aux Zélés Philanthropes par Adolphe Mendès Da Costa, de quinze ans son aîné. Deux indices plaident en ce sens : l’un et l’autre habitaient rue Sainte-Placide à Paris, et Da Costa était comptable, la profession de Jourde. Da Costa, déjà Rose-Croix, se préparait à devenir Vénérable des Zélés Philanthropes. Il s’attachera à ouvrir pour Jourde une carrière maçonnique honorable, et le protègera longtemps des conséquences de ses excès.
Six mois à peine après son entrée, le 26 avril 1867, François Jourde fut élevé aux grades de compagnon puis de maître. Le même jour il est élu Orateur, ce qui lui permettra vite d’exprimer ses qualités de juriste et son sens de la synthèse. Il n’avait pas 24 ans ! Réélu Orateur le 13 décembre 1867, il vise ès qualités l’état des effectifs où il se dit « étudiant libre » et déclare comme domicile 32 rue de Buci. C’est encore lui qui, cette année-là, signe la demande de banquet qui se tiendra à 6h1/2 « chez le F . : Constant, rue de la Gaîté, après la tenue » qui avait lieu à 4 heures. Il paraphe neuf radiations le 14 août 1868. Rien à dire sur les premiers pas de Jourde aux Zélés.
Fin 1868, Da Costa, promu vénérable d’honneur, est remplacé par Hubert, un fonctionnaire préfectoral de 50 ans, nouveau venu dans la loge mais bien connu dans la franc-maçonnerie, moins pour son charmant prénom (Esprit, ou Esprit Eugène) que du fait de ses activités insatiables et multiples au service de l’Ordre. Ce dont il se plaignait d’ailleurs volontiers, écrivant dans La Chaîne d’Union qu’il ne pouvait « travailler qu’entre 2h et 6h du matin … Qui voudrait de mon existence ? ». Bien qu’opposant à l’Empire, Hubert se montrait conservateur en franc-maçonnerie. C’est lui qui, en juillet 1869, fera circuler un manifeste pompeux prônant l’interdiction en loge « de toutes discussions qui auraient pour objet soit la controverse sur les différentes religions, soit la critique des actes de l’autorité civile et des différentes formes de gouvernement ». Texte qu’il signera « Hubert, député Vén . : de la loge Les Zélés Philanthropes, Orient de Vaugirard ». Car, un an avant la chute de l’Empire, la franc-maçonnerie bougeait.
OFFICIER ET DELEGUE DES ZELES PHILANTHROPES A LA CHAMBRE D’APPEL MACONNIQUE
Pourtant, non seulement Hubert reprit Jourde dans son collège comme Orateur, mais encore il lui fit cumuler cette fonction avec celle, fort délicate, de délégué de la loge auprès de la Chambre d’Appel maçonnique. Voilà Jourde juge avant que d’être un jour jugé … Mais sa vie personnelle et son activité politique l’absorbaient. Son père était mort, et il lui avait fallu régler la succession. Il plaça sa part en banque, abandonna les intérêts à sa mère de même que les loyers de la maison d’Auvergne. La raideur et les idées d’Hubert n’encourageaient pas les débats de société qu’il affectionnait. L’Illustration affirme : « Il fréquenta certains cafés du Quartier Latin, où il rencontra des étudiants en droit et en médecine (…). C’est dans cette société qu’il puisa (…) les notions superficielles qui lui ont servi à élaborer son projet de loi sur les échéances ». Plusieurs témoignages le confirment, de même que ses changements incessants de domicile : il était déjà bien engagé dans la lutte pour un nouveau monde, et la police le surveillait. Enfin, sans emploi, il était impécunieux. Hildevert Turpin, secrétaire, signa pour lui la demande de banquet solsticial « chez le F . : Ragache, rue Lecourbe ».
Fin 1869, Hubert les ayant abandonnés, les Zélés Philanthropes, faute de candidats, demandèrent à Evangéliste Fleury de reprendre le premier maillet, qu’il avait déjà tenu de décembre 1859 à décembre 1865. Homme d’ordre, Fleury n’allait pas tolérer les manquements d’un officier dont le rôle était essentiel, et qui de surcroît ne payait pas ses cotisations – un motif automatique d’exclusion. Il le fait donc radier le 12 mars 1870 mais Jourde est seulement déclaré « en congé » sur la pièce correspondante. La radiation est pourtant constatée le 8 avril, et c’est le F . : Pinot, marchand de vins, qui paraphe l’état des effectifs, faisant précéder sa griffe de la mention « Pour l’orateur radié, le suppléant ». Jourde habite maintenant 20 rue Cujas. L’effectif chuta à 39.
Là s’interpose un autre épisode curieux. Le 1er juin 1870, Fleury a des empêchements et « le T . : C. : F. : Turpin, secrétaire » est nommé à l’unanimité « à l’effet de suppléer à l’absence de notre président titulaire ». Le fait est signalé à l’Obédience par l’ancien Vénérable Da Costa, qui signe « Pour l’orateur démissionnaire ». Démissionnaire ou radié ? Manifestement, la loge traversait un creux. Mais il n’y avait pas que ça. Des bruits de bottes résonnaient en Europe. En juillet 1870, la France déclarera la guerre à la Prusse. Da Costa avait pu profiter de ces circonstances troublées pour empêcher le couperet de tomber sur son jeune ami.
Après, la vie devint difficile. L’Empire disparut en septembre et fut remplacé par un « Gouvernement de la Défense Nationale », vite atteint de paralysie. Les Allemands assiégèrent Paris, dont les habitants durent manger chevaux, chats et rats. Affamé comme tous, Jourde partit restaurer sa santé dans son village natal. Mais, indique L’Illustration, « dès la première nouvelle des évènements qui ont abouti à la création de la Commune de Paris, il (…) revint s’installer dans la capitale. La fréquentation assidue des clubs, les suffrages des agitateurs, le mirent bientôt en évidence … »).
Les Zélés Philanthropes poursuivirent leur chemin tant bien que mal. En mars 1871, la loge élut comme vénérable Joseph Décembre, un contremaître typographe qui avait publié différents ouvrages avec son beau-père Edmond Allonier. Décembre, républicain légitimiste, ne pouvait qu’être hostile à l’insurrection du 18. Que Jourde fit partie des meneurs ne le portait pas à l’indulgence. Ainsi, c’est Jourde qui avait annoncé à la foule que le Panthéon était une nouvelle fois retiré au culte pour être affecté à la sépulture des grands hommes. Mais que faire ? Beaucoup de gens quittaient Paris. Jourde, sans profession, était aussi sans revenu. Le 25 mars, Décembre laissa donc le secrétaire l’inscrire encore sur l’état des effectifs, comme « maître et délégué à la Chambre d’Appel », avec le numéro 23.
RADIE POUR CONDUITE INDIGNE DANS LA VIE PROFANE ET NON PAIEMENT DES COTISATIONS
Jourde, très occupé, ignora ces péripéties. Pourtant, tout délégué aux Finances qu’il fût, avec les responsabilités qu’on a décrites, il ne perdit pas de vue la franc-maçonnerie. Faute de place, on se contentera de renvoyer à ce dont témoignent affiches et documents. S’il ne fit pas partie de la délégation qui alla voir Thiers et Jules Simon à Versailles, la participation de Jourde aux folles journées d’avril, qui vit des centaines de francs-maçons parisiens se rassembler au Châtelet et décider d’aller planter leurs bannières sur les remparts, est certaine. On alla avertir la Commune de cette décision, ensuite de quoi, dit Daniel Ligou, « une délégation avec les Frères Jourde, Benoît Malon, Lefrançais et Pyat ramènera les quelque 2000 maçons rue Cadet ». Scène également racontée par Léo Campion. Le Conseil de l’Ordre vit là « une initiative personnelle de quelques maçons sans mandat ». Et elle ne sera sans doute pas oubliée.
Le vendredi 9 juin, la loge se réunit dans son temple habituel. L’insurrection avait été écrasée dans le feu et le sang. Jourde n’avait pas été fusillé. Au fond d’un cachot de Versailles, il était promis à comparaître devant la justice militaire. Fallait-il attendre le verdict pour se prononcer ? C’est ce qu’on faisait généralement dans les cas de faillite. Pourtant, ce fut sans ambiguïté : « Jourde Francis, sans profession, demeurant 12 rue Monge, est rayé pour conduite indigne dans la vie profane et défaut de paiement de ses cotisations ». On avertit le Grand Orient le 17 juin. Les Zélés Philanthropes ne faisaient que refléter la pensée du Conseil de l’Ordre (« la maçonnerie est restée parfaitement étrangère à la criminelle sédition qui a épouvanté l’univers … »).
Trois mois plus tard, le 2 septembre 1871, Jourde savait-il, en entendant tomber la sentence du Conseil de Guerre le condamnant à la déportation en Nouvelle-Calédonie, que l’avait précédée la décision d’exclusion de sa loge ? C’est peu probable. L’apprit-il dans sa geôle de Fort Boyard ou sur le ponton de Brest d’où il allait s’embarquer, le 13 juin 1872, en compagnie de Paschal Grousset, sur la vieille frégate La Guerrière ? On ne le croit pas. Peut-on imaginer que l’un de ses compagnons d’infortune de l’Ile des Pins ou de Nouméa la lui aient rapportée ? Son comportement laisse plutôt penser le contraire. Car la franc-maçonnerie fut impliquée dans son évasion, et lui-même, de retour en Europe, réclamera aux Zélés Philanthropes son passeport maçonnique. Il reste là quelques mystères que nous essayerons d’élucider dans un prochain article.
Sources principales : Archives de la Banque de France. Archives maçonniques (BN et GODF). Archives Nationales. Archives militaires. « Les Zélés Philanthropes, cent cinquante ans de travail maçonnique au REAA », 1984. « La Banque de France et la Commune de Paris », mémoire de maîtrise d’Eric Cavaterra, 1996. Revue des Deux Mondes, 1871 et 1971. Revue Vie & Sciences Economiques, n° 148-149 et 150. L’Illustration, 1871. Etc.
Documents photographiques gracieusement prêtés par Raymond Dréan-Duacin.( pas disponible en ligne)
A L’ORIGINE DE QUELQUES AVANCEES PHILANTHROPIQUES (encadré)
Le rôle déterminant que joua François Jourde dans la recherche de fonds pour la Commune trouvait son inspiration dans une disposition générale, dont on connaît la source, pour la philanthropie et la bienfaisance.
Ainsi fut-il l’inspirateur des mesures destinées à soulager les pauvres gens qui, très nombreux, avaient déposé des objets au Mont-de-Piété pour se nourrir, et ne pouvaient les retirer faute de revenus. Le 29 mars, un décret suspendit la vente des objets déposés en gage. C’était trop peu. Le 25 avril, on en reparla à la Commune qui, finalement, vota le projet Jourde qui annulait les reconnaissances de dettes antérieures au 25 avril et inférieures à 20 F. Il y avait 1,8 million d’objets gagés ! Ils furent remis à leurs propriétaires par deux tirages au sort qui connurent un grand succès.
On lui impute aussi l’idée d’un projet de loi sur les échéances, finalement rendue publique sous le nom de projet Beslay. Celui-ci, sorti mi-avril, suspendait toutes les poursuites pour cause de dettes échues et non payées et repoussait au 15 juillet leur remboursement. Ce qui déclencha la fureur des créanciers.
Il est encore le co-auteur d’un projet de décret donnant la préférence aux associations ouvrières dans les marchés à venir.
A son crédit encore, un projet de pension pour les compagnes (mariées ou non) des gardes nationaux tués au combat.
Enfin, Jourde (Rigault aussi, pour l’aspect policier) s’occupa des services de vente en gros dans les halles et marchés, mais il semble avoir été animé là surtout par le souci de faire rentrer les taxes dans ses caisses toujours vides …